Les résultats de cette tradition d’études convergent globalement : le comportement de l’entreprise autogérée serait globalement moins efficace que celui de son homologue capitaliste, en ce sens que les incitations y pousseraient à faire stagner la production plutôt qu’à travailler à son accroissement. C’est Ward qui, le premier, a souligné ces effets, en partant du principe a priori réaliste selon lequel, dans l’entreprise autogérée, chaque entreprise vise à maximiser sa rémunération. Dans ces conditions, l’entreprise autogérée tend à embaucher moins que l’entreprise capitaliste : chaque nouvelle embauche aboutit en effet à un partage des profits. Dès lors, pour que l’entreprise embauche, il faudra que la productivité marginale du travailleur supplémentaire soit supérieure au coût moyen du travail pour l’entreprise, et non à son coût marginal, comme cela est le cas dans l’entreprise classique. Cela conduit à n’embaucher que dans la phase de rendements croissants du travail, conduisant ainsi à un niveau d’emploi plus faible que dans le cadre capitaliste. Par ailleurs, l’autogestion aboutit également à réduire les incitations à investir. Les bénéfices réinvestis dans l’entreprise ne sont en effet pas distribués aux travailleurs, mais ne leurs permettent pas non plus de constituer un capital. Lorsqu’ils réinvestissent leurs bénéfices, les travailleurs y perdent tout droit individuel au profit du collectif de travail. Du point de vue de la maximisation de leurs revenus, ils ont donc tout intérêt à investir le strict nécessaire pour se trouver en conformité avec la loi (Dans le cas Yougoslave, la loi obligeait en effet à conserver intact la valeur du capital de l’entreprise).
Naturellement, les analyses micro-économiques de la firme yougoslave ne sont pas applicables, comme telles, aux coopératives de production. Elles reposent en effet sur une structure particulière des droits de propriété, structure caractérisée par le fait que l’entreprise n’y est pas propriété des travailleurs, mais propriété de la société. Si l’entreprise est possédée par ceux qui y travaillent, et que chacun d’entre eux est susceptible de récupérer en définitive ce qu’il y a investi, alors le problème du sous-investissement devrait disparaître. En effet, en conservant l’hypothèse de maximisation du revenu comme déterminant du comportement des travailleurs, on arrive à une situation dans laquelle les travailleurs associés se trouvent désireux de maximiser à la fois les revenus de leur travail et ceux de leur capital. Leur comportement devrait alors être identique à celui d’une entreprise capitaliste. Pourtant, de nombreux modèles micro-économiques mettent en doute cette conclusion, en s’appuyant principalement sur des arguments tirés de la théorie de la diversification du portefeuille. C’est Meade qui, semble-t-il, a le premier ouvert la voie à cette argumentation, avec son article intitulé The theory of Labor-Managed firms and of Profit Sharing (1972). L’idée est simple : alors que l’investisseur capitaliste peut diversifier ses placements de façon à minimiser son risque, celui qui désire investir dans sa propre entreprise est obligé de concentrer tous les risques. Il est ainsi plus rationnel, pour les travailleurs associés, d’investir les bénéfices de leur activité hors de leur propre firme, sur le marché financier, de façon à diversifier leur portefeuille et à obtenir un rendement équivalent pour un risque inférieur. Là encore, ce sous-investissement est voué à entraîner une moindre croissance des firmes, et donc leur dispersion au sein d’un environnement concurrentiel. Exit, là encore, l’autogestion, toujours pour cause de sous-investissement.
L’analyse ne peut toutefois se limiter à ce pessimisme micro-économique. Les modèles reposent toujours sur des hypothèses fortes et simplificatrices, et leurs prédictions ne sauraient être acceptées pour argent comptant sans être confrontées à la réalité des faits. De ce point de vue, les études empiriques de qualité manquent. Une étude de grande ampleur, menée par Defourny sur plus de 500 SCOP française dans les années 1970 s’intéresse surtout à leur performance, à partir de ratios financiers. Elle confirme, globalement, les intuitions primordiales qui justifient la pensée autogestionnaire : les performances des SCOP apparaissent comme supérieures à celles d’entreprises capitalistes équivalentes, et cette supériorité trouve sa source dans la participation des travailleurs aux profits et aux décisions. En soi, toutefois, ce résultat passe à côté de la question : les entreprises autogestionnaires peuvent parfaitement être capables de produire plus efficacement que leurs homologues capitalistes, sans investir suffisamment. Elles ont alors de moins en moins d’entreprises qui leur soient à proprement parler homologues, ce qui entraîne leur évincement du marché. La question est donc de savoir si les entreprises autogérées adoptent effectivement des comportements nuisibles à l’investissement.
D’autres études empiriques semblent suggérer que non, comme par exemple celle menée en 1992 par Rooney, par le biais d’entretien avec des présidents de coopératives. Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette situation. La plupart tiennent à ce que les entreprises autogérées réellement existantes ne suivent pas la fonction objectif que leur prêtent les modèles. Dans la réalité, les entreprises autogérées cherchent prioritairement à défendre l’emploi de leurs membres, ensuite, à diminuer leur temps de travail. Le revenu rentre évidemment en compte dans leurs calculs, mais à travers une perspective qui est moins celle de la maximisation que de la préservation d’une certaine stabilité. L’ajustement du revenu permet de réagir aux variations de l’activité, comme aux réorganisations de l’activité vers plus de temps libre, à la condition de ne pas descendre en dessous d’un certain minimum.
Au-delà de cette diversité des objectifs économiques, il convient également de souligner que les entreprises autogérées poursuivent, particulièrement dans les économies capitalistes, une vaste gamme d’objectifs extra-économiques. La coopérative naît toujours dans l’adversité, elle est initialement portée par un mouvement social et se veut une leçon morale et politique adressée au monde, une façon de prouver la possibilité d’un autre monde en le faisant partiellement advenir ici et maintenant. En ce sens, ses membres sont liés à son devenir autrement que par le simple calcul économique. Tout laisse à croire qu’ils investiront dans la coopérative non parce que cela est économiquement rationnel, mais parce qu’elle est leur projet : on retrouve ici la thématique des esprits animaux animant l’entrepreneur, portée cette fois au niveau du collectif. On peut toutefois être sceptique quant à la capacité de telles motivations à porter l’entreprise autogérée au-delà d’une certaine taille, à partir de laquelle la rationalité calculatrice devrait logiquement reprendre le dessus.
L’absence de convergence entre les observations empiriques et les prédictions des modèles micro-économiques doit ainsi nous inciter à ne pas reculer devant cette question provocatrice : ces modèles ont-ils la moindre pertinence, ou ne sont-ils que des constructions formelles et désincarnées, passant totalement à côté de la réalité de l’entreprise autogérée ? La littérature existante a trop facilement tendance à privilégier cette dernière option, qui présente l’avantage considérable de permettre d’évacuer le problème des incitations sous-efficientes de l’entreprise autogérée comme non-existant. La réalité est pourtant probablement plus complexe. Dans l’état actuel des choses, la plupart des entreprises autogérées naissent dans un contexte social extrêmement particulier, marqué à la fois par de fortes difficultés économiques et un projet politique clairement énoncé, celui de « produire autrement ». En ce sens, les entreprises autogérées ne sont pas des entreprises « normales », et peut être est-ce de cette anormalité qu’elles tirent leur force, c’est à dire leur capacité à adopter un comportement plus efficace que celui auquel leur système d’incitations semble les condamner. Mais l’articulation d’un projet autogestionnaire global et réaliste interdit de se satisfaire d’une telle réponse, vouée par définition à convenir à des firmes situées en marge de la société, et construites en partie contre ses valeurs dominantes. Si l’autogestion doit devenir le mode dominant d’organisation de la société, elle ne peut pas tenir par la seule force de la morale, moins encore celle d’une morale tirant sa force de conviction de sa position marginale. C’est pourquoi les discussions autour de la fonction objectif de l’entreprise autogérée restent fondamentales. Si elles ne fournissent qu’un modèle, simplifié par définition, du comportement de l’entreprise autogérée, elles permettent d’identifier un certain nombre de difficultés sur lesquelles celle-ci est susceptible d’achopper. Cette identification réalisée par le biais du raisonnement micro-économique, et partiellement corrigé sous l’influence d’études empiriques, doit ainsi permettre de concevoir des formes d’organisation des droits de propriété permettant à l’autogestion de fonctionner de façon aussi efficace que possible. Dans le cas présent, cela signifie principalement organiser l’autogestion de façon à favoriser l’investissement.
Il n’en reste pas moins que les modèles micro-économiques de l’entreprise autogérée ne permettent pas de comprendre le faible développement des coopératives. Celui-ci reste donc toujours problématique. D’autres approches économiques, se concentrant davantage sur l’environnement des firmes, sont ici susceptibles d’être éclairantes. Elles fournissent par ailleurs un autre levier d’action, consistant cette fois dans la modification de l’environnement plutôt que dans celle du système d’incitations. La difficulté de l’entreprise autogérée à se financer apparaît de nouveau centrale, mais elle s’explique ici moins par son propre comportement que par l’attitude des organismes de crédit à son égard, qui contribuent à handicaper l’entreprise autogérée par rapport à ses rivales. L’effet d’antisélection joue par plusieurs canaux. Il est possible de douter de la sympathie du banquier moyen pour toute tentative autogestionnaire. Si celui-ci a un vernis d’économie, il ne lui est par ailleurs pas difficile de justifier sa répulsion spontanée. Il serait toutefois vain de tout ramener à des biais idéologiques : même en leur absence, l’entreprise autogérée est vouée à se trouver en situation défavorable vis-à-vis de l’emprunt. Vouées à se financer par endettement, les entreprises autogérées n’ont pas de collatéral à offrir. A mesures que les entreprises croissent, ce problème devient d’autant plus important que les équipements à financer ne cessent de coûter plus cher alors même que les capacités contributives des coopérateurs ne varient pas dans les mêmes proportions. Les coopératives se trouvent donc dans la situation de nombreuses petites entreprises, qui n’apparaissent pas suffisamment sures pour que des prêts leurs soient octroyées. Elles restent donc condamnées à une position subalterne dans l’économie.
Qu’on les explique par des difficultés intrinsèques ou par des contraintes environnementales, c’est ainsi le financement de l’investissement qui apparaît comme la principale difficulté à laquelle est confrontée l’entreprise autogérée. Deux types de solutions découlent de ce constat de façon relativement évidente. En ce qui concerne l’entreprise autogérée elle-même, il faut voir en quoi sa spécificité lui fournit des leviers permettant d’accéder à des sources alternatives de financement. En matière de politiques publique, tout dispositif permettant de favoriser l’accès des petites entreprises au crédit sans discriminations est également susceptible d’aider les coopératives.
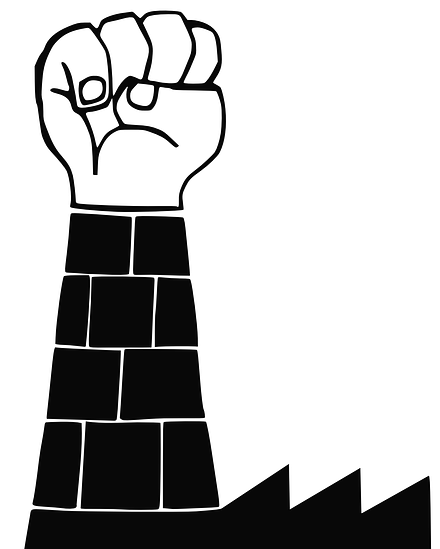

Laisser un commentaire